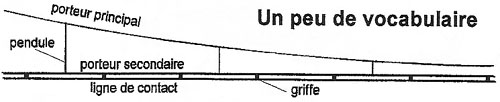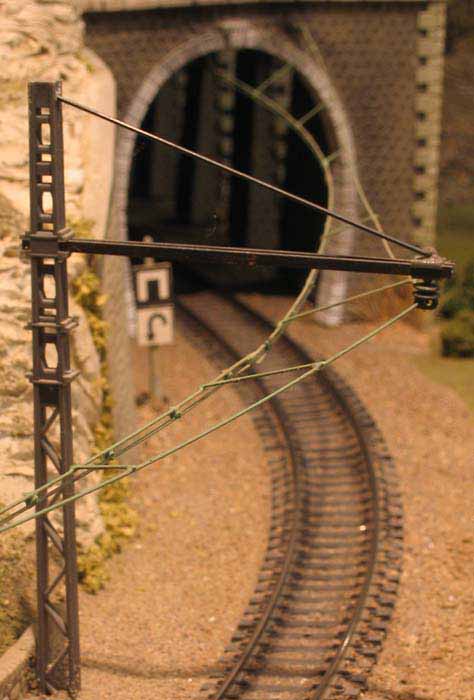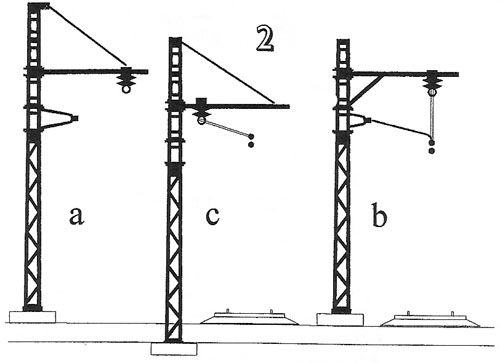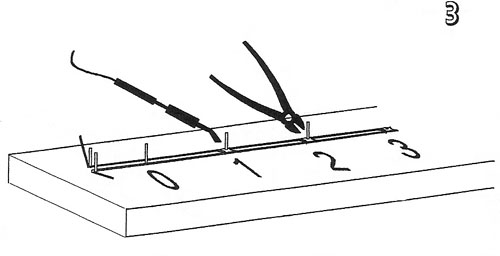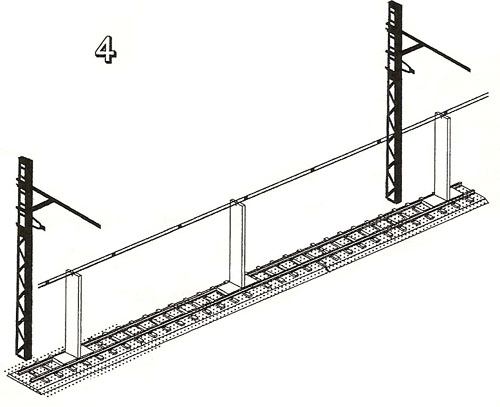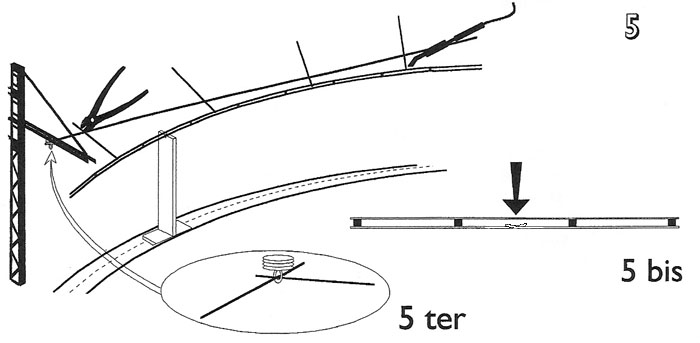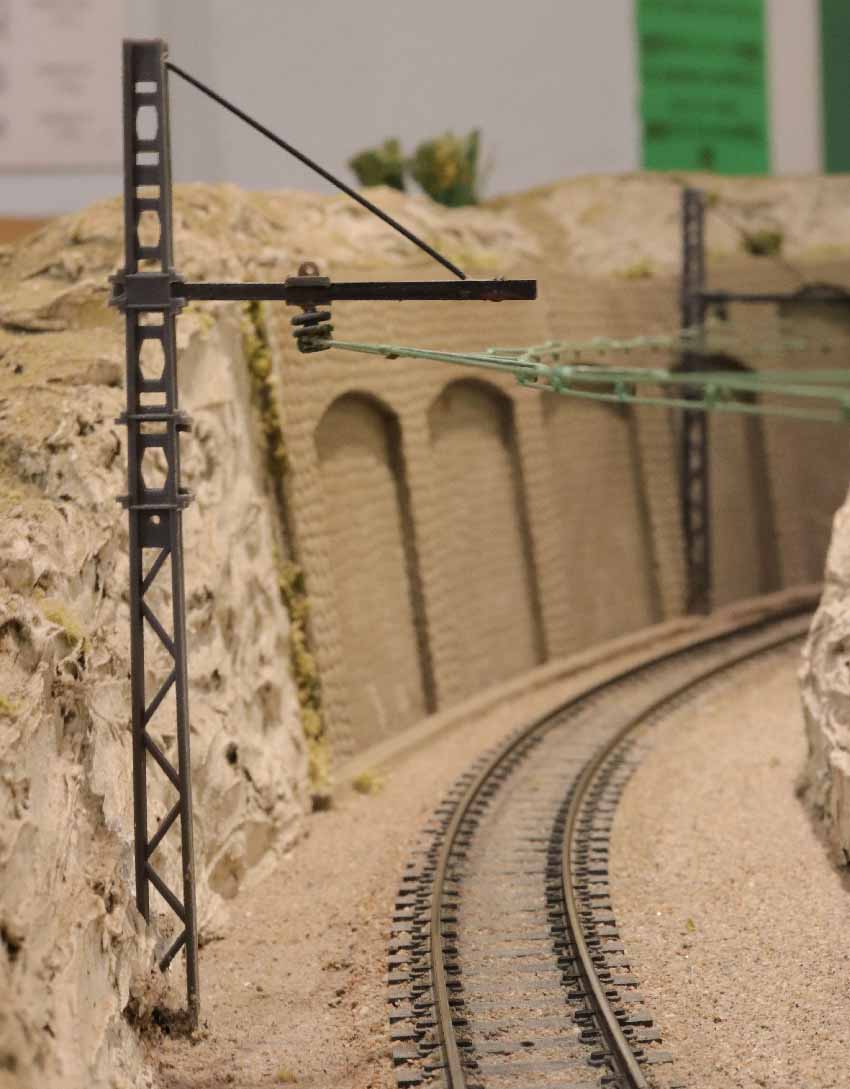|
Construire sa caténaire inclinée type Midi.
|
Même si notre réseau ne représente
pas de sites réels, nous l'avons délibérément ancré dans le Midi de la
France, et, pour les amateurs de chemin de fer que nous sommes, nous
nous situons clairement dans une région dépendant de l'ancienne
Compagnie du Midi. Comme nous voulions pouvoir faire rouler toutes
sortes de matériels, donc des machines électriques, il était clair que
nous devrions équiper une partie de nos voies de caténaires, mais il se
trouve que la caténaire Midi est assez différente des systèmes utilisés
dans d'autres régions, plutôt originale, et, à notre goût, très belle.
Tout pour nous séduire Mais quand on sait ce qui fait son
originalité, et sa beauté, les problèmes commencent à se poser
sérieusement aux modélistes que nous sommes. |
 |
| Le système d'alimentation en courant électrique par fil
de contact « à suspension caténaire » se présente le plus souvent de la façon suivante : les machines sont munies
d'un archet ou d'un «
pantographe » dont les palettes viennent frotter sur un fil électrique
installé au-dessus des voies. Premier problème : en ligne droite, ça va,
mais dans les courbes, le fil (souple mais tendu) ne peut pas suivre
exactement la forme du tracé, aussi dessine-t-il un polygone (fig. 1a.)
On appelle d'ailleurs ces caténaires « polygonales ». |
|
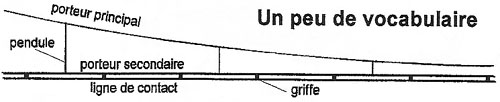 |
|

|
| |
|
La
caténaire Midi, quant à elle, résout le problème par un système élégant
de tensions réparties, qui amène le fil de contact à épouser presque
parfaitement les sinuosités de la voie. Pour atteindre à ce résultat,
les câbles porteurs sont disposés de telle façon que les « panneaux » de
caténaire s'inclinent dans les courbes presque jusqu'à l'horizontale. Il
faut avoir suivi une ligne ainsi équipée pour en apprécier la complexité
géométrique, mais aussi l'harmonie, en particulier dans les zones où
courbes et contre-courbes se succèdent (fig. 1b). |
 |
|
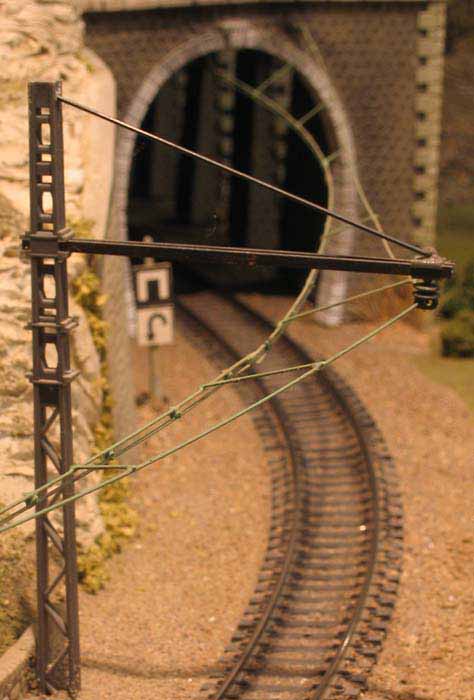 |
Comme le fil de contact
doit être disposé à une hauteur définie, (quelque peu variable,
cependant), et comme le développement vertical du système dépend de son
inclinaison, on comprend que la fixation impose quasiment pour chaque
poteau une disposition différente.
La caténaire est située à une
hauteur de 5,20 mètres (59.8mm) en moyenne. Elle peut descendre à 4,31 mètres
(49.5mm),
sous les ponts-routes et les tunnels, et atteindre 6,20 mètres (71.3mm) sur les
passages à niveau. |
|
Tout cela fait que pour le modéliste, la pose d'une
caténaire Midi se présente comme un défi que, pourtant, nous avons
souhaité relever. Mais comme nous sommes un peu paresseux, nous avons
cherché les moyens de nous en tirer sans trop de migraines. Commençons
par les poteaux. Nous avons utilisé des poteaux JV type Sud-Est, (dessin
2 a), très solides et jolis, qu'il nous a quand même fallu un peu
bricoler. Le dessin 2 montre les transformations mises en œuvre pour
obtenir les deux types de poteaux dont nous avions besoin. Pour ceux à
console haute (ligne droite, dessin 2 b), nous avons recoupé le sommet
des poteaux JV afin d'amener la console plus près du sommet du poteau,
et un peu rabougri le support d'antibalançant qui nous semblait trop
long pour notre usage Midi. Pour les poteaux à console basse (en courbe,
dessin 2 c), nous avons simplement supprimé le support d'antibalançant
(inutile), et nous avons fixé les poteaux par en dessous, ce qui les
fait descendre d'environ 1 cm. Tous les poteaux retrouvent donc une
hauteur d'à peu près 110 mm au-dessus du sol, mais les consoles se
trouvent à des hauteurs différentes, comme en réalité. Nous avons aussi
supprimé le support du tirant supérieur que nous trouvions trop lourd d'aspect. Aux poteaux
"bas", nous avons ajouté un tirant en corde à
piano, fiché dans un trou et collé, aux poteaux "hauts", nous avons
ajouté des étais à 45° découpés dans des chutes des consoles et collés
en place. Tout ceci est un peu simpliste et ne reproduit pas la réalité
à 100%, mais l'allure générale est bonne, et c'est facile à faire... |
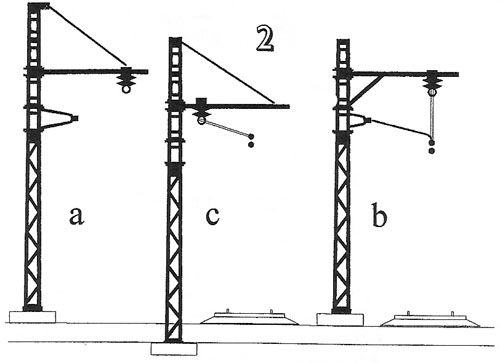
 |
| Les poteaux sont installés à des intervalles qui varient
entre 30 et 35 cm dans les courbes serrées, et 40 et même jusqu'à 47 cm
en ligne droite. Passons maintenant à la caténaire proprement dite.
Nous avons utilisé du fil de bronze de 5/10èmes
(résistant à l'étirement) acheté en rouleau chez
Weber à Paris. Il nous a fallu compter 3 fois autant de fil que nous
avions de mètres à équiper. La première tâche a consisté à
fabriquer l'ensemble fil de contact - fil porteur secondaire. Ces deux
câbles sont, dans la réalité, espacés de 4,7 cm, et reliés par des
griffes disposées à un intervalle qui varie en fonction du rayon de la
courbe qu'on équipe. Pour nous simplifier le travail, nous avons limité
à 3 les variantes possibles. Pour les lignes droites, les griffes sont
espacées de 5 cm, dans les courbes à grand rayon, l'espace se réduit à
3,5 cm, et dans les courbes serrées à 2,5 cm. Mais passons à la
pratique. Nous avons d'abord préparé un banc de travail bien simple :
une planche de bois dur bien plate a été percée de trous aux intervalles
choisis (2,5, 3,5 ou 5 cm), parfaitement alignés, sur une longueur d'à
peu près 1 mètre (fig 3). Dans ces trous, des tronçons de fil de laiton
de 1 mm de Ø sont fichés. De part et d'autre, deux brins de fil de
bronze sont tendus, entre des pions constitués de clous solidement
plantés, et guidés de place en place par des clous sans tête. Les deux
brins et les entretoises en laiton sont alors soudés ensemble. Avec une
pince coupante, il ne reste plus qu'à tronçonner à ras les éléments
superflus, ne gardant que les « griffes » minuscules mais très solides. |
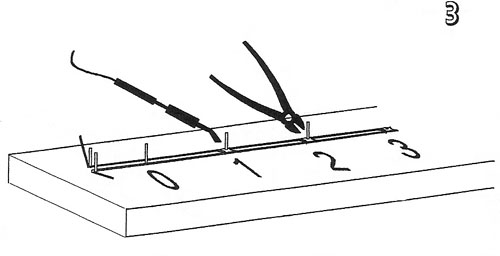 |
Le résultat constitue une sorte d'échelle, qui se laisse courber
sans peine dans le sens horizontal, mais très rigide dans le sens
vertical.
Ces brins ont été disposés au-dessus de la voie, à la bonne hauteur et
bien alignés, par l'intermédiaire de supports provisoires découpés dans
du carton-plume (fig. 4) |
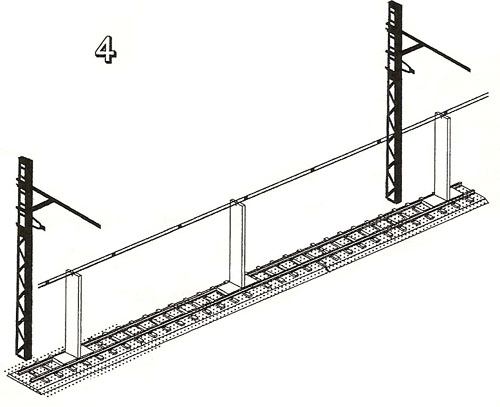 |
Rappelons que l'ensemble porteur
secondaire + fil de contact est toujours disposé verticalement, en ligne
droite comme en courbe. |
|
Nous avons ensuite disposé le porteur principal, brin
par brin entre les poteaux, formant une courbe régulière d'un isolateur
au suivant, et descendant jusqu'à environ 5 mm du porteur secondaire, au
plus bas. Dans les lignes droites, ce porteur est situé à la verticale
du porteur secondaire + fil de contact. Mais dans les courbes, ça se
complique. La forme du porteur est une résultante de diverses forces de
traction contradictoires. En gros, la fixation aux poteaux tire le câble
vers l'extérieur de la courbe, la pesanteur tire vers le bas, et c'est
en tendant tout le bazar qu'on amène le fil de contact à la bonne
hauteur et au bon endroit au-dessus des rails. Pour nous, le problème
est un peu différent, puisque nous ne tendons pas le fil. Il faut lui
donner une courbure vraisemblable, à l'instinct, puis commencer à souder
les pendules « à vue de nez ». Nos pendules sont de petits brins de fil
de bronze, formés en crochet à un bout, ce qui facilitera leur accroche
du porteur secondaire. Nous les avons positionnés et soudés un à un à
l'intervalle (réaliste) de I pour deux griffes, en commençant par le
plus court (au milieu du panneau). L'extrémité « haute » repose contre
le porteur principal, puis y est soudée légèrement. Pendule après
pendule, le panneau prend forme. Quand tous les pendules sont placés, on
vérifie l'effet général. Il faut souvent redresser l'alignement ici ou
là , en dessoudant fugitivement le haut de quelques pendules pour
permettre au porteur de trouver sa position d'équilibre. |
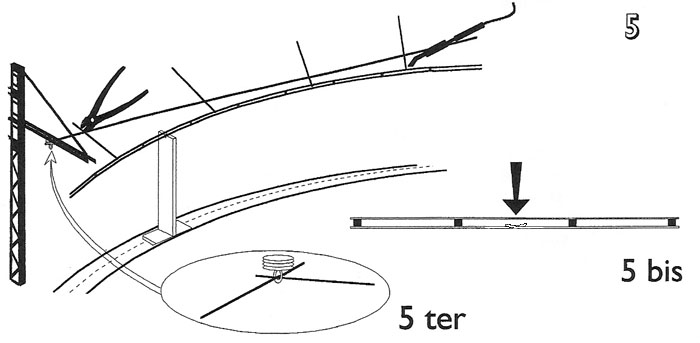
 |
Quand on arrive au bout d'un brin de « l'échelle » de base, on y soude le brin suivant par le porteur
secondaire seulement, en relevant les extrémités du fil de contact en
spatule de ski à la pince, sur quelques mm (fig. 5 bis) Panneau après
panneau la caténaire prend forme. Dès qu'un ou deux panneaux sont
terminés, il est bon de contrôler leur tenue en faisant passer une
machine, pantographe levé. Si le fil s'écarte trop du centre de l'archet, il faut rectifier (dessouder, rallonger ou raccourcir les
pendules...). Alors seulement, on peut éliminer à la pince coupante les
bouts des pendules qui dépassent vers le haut. Tant que les panneaux
sont libres à leur extrémité encore non terminée, la caténaire est assez
souple, et monte sous la pression du pantographe mais au fur et à mesure
de l'avancement du chantier, l'ensemble se rigidifie, et les petits
mouvements de la caténaire terminée ne font que reproduire ceux qui se
produisent aussi dans la réalité. Les extrémités des brins de porteurs
principaux qui se croisent dans les isolateurs des poteaux gagnent à
être soudés entre eux, mais gare à ne pas faire fondre les isolateurs
(en plastique). On peut aussi les fixer à la colle instantanée (fig. 5
ter). On coupe enfin ce qui dépasse. Voilà , la caténaire est terminée,
les essais satisfaisants. Cela passe partout sans accrocher, le
pantographe de la machine ne part jamais « en l'air », il touche
toujours le fil. Parfait, il ne reste plus qu'à peindre le fil d'une
jolie couleur bronze oxydé (vert de gris). Nous avons choisi un vert
amande (Humbrol n° 120) qui rend la caténaire encore plus discrète, la
fait paraître encore plus fine. Un délice !
Les
spécificités.
Le branchement en Y avec les deux directions en courbe.




La courbe en sortie de gare. On
distingue bien les 3 poteaux différents de cette section entre le pont
et le pare éboulis.

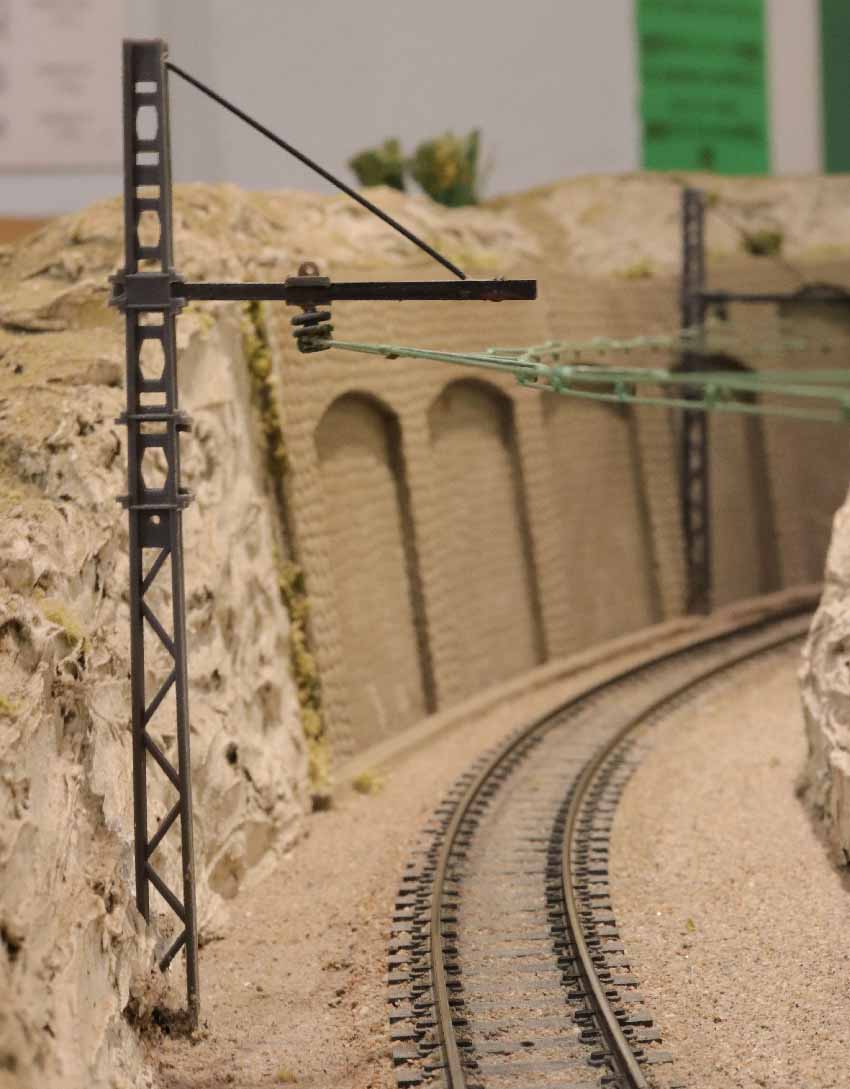

Voir les
VIDÉOS. |